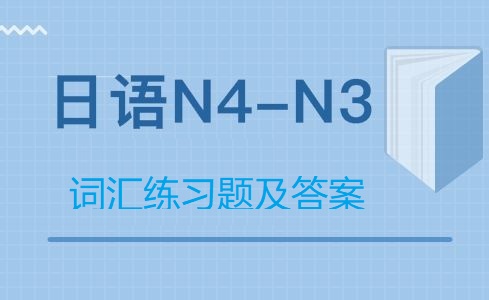法语阅读:Amant 情人-杜拉斯(3)
|
Quinze ans et demi. La chose se sait très vite dans le poste de Sadec. Rien que cette tenue dirait le déshonneur. La mère n’a aucun sens de rien, ni celui de la fa?on d’élever une petite fille. La pauvre enfant. Ne croyez pas, ce cha-peau n’est pas innocent, ni ce rouge à lèvres, tout ?a signifie quelque chose, ce n’est pas innocent, ?a veut dire, c’est pour attirer les regards, l’argent. Les frères, des voyous. On dit que c’est un Chinois, le fils du milliardaire, la villa du Mé-kong, en céramiques bleues. Même lui, au lieu d’en être honoré, il n’en veut pas pour son fils. Famille de voyous blancs. La Dame on l’appelait, elle venait de Savannakhet. Son mari nommé à Vinhlong. Pendant un an on ne l’avait pas vue à Vinhiong. A cause de ce jeune homme, adminis-trateur-adjoint à Savannakhet. Ils ne .pouvaient plus s’aimer. Alors il s’était tué d’un coup de revolver. L’histoire est par-venue jusqu’au nouveau poste de Vinhiong. Le jour de son départ de Savannakhet pour Vinhiong, une balle dans le c?ur. Sur la grande place du poste dans le plein soleil. A cause de ses petites filles et de son mari nommé à Vinhiong elle lui avait dit que cela devait cesser. Cela se passe dans le quartier mal famé de Cholen, chaque soir. Chaque soir cette petite vicieuse va se faire caresser le corps par un sale Chinois millionnaire. Elle est aussi au lycée où sont les petites filles blanches, les petites sportives blanches qui apprennent le crawl dans la piscine du Club Sportif. Un jour ordre leur sera donné de ne plus parler à la fille de l’institutrice de Sadec. A la récréation, elle regarde vers la rue, toute seule, adossée à un pilier du préau. Elle ne dit rien de ?a à sa mère. Elle continue à venir en classe dans la limousine noire du Chinois de Cholen. Elles la regardent partir. Il n’y aura aucune exception. Aucune ne lui adressera plus la parole. Cet isolement fait se lever le pur souvenir de la dame de Vinhiong. Elle venait, à ce moment-là, d’avoir trente-huit ans. Et dix ans alors l’enfant. Et puis maintenant seize ans tandis qu’elle se souvient. La dame est sur la terrasse de sa chambre, elle regarde les avenues le long du Mékong, je la vois quand je viens du catéchisme avec mon petit frère. La chambre est au centre d’un grand palais à terrasses couvertes, le palais est au centre du parc de lauriers-roses et de palmes. La même différence sépare la dame et la jeune fille au chapeau plat des autres gens du poste. De même que toutes les deux regardent les longues avenues des fleuves, de même elles sont. Isolées toutes les deux. Seules, des reines. Leur disgrace va de soi. Toutes deux au discrédit vouées du fait de la nature de ce corps qu’elles ont, caressé par des amants, baisé par leurs bouches, livrées à l’infamie d’une jouissance à en mourir, disent-elles, à en mourir de cette mort mystérieuse des amants sans amour. C’est de cela qu’il est question, de cette humeur à mourir. Cela s’échappe d’elles, de leurs chambres, cette mort si forte qu’on en conna?t le fait dans la ville en-tière, les postes de la brousse, les chefs-lieux, les réceptions,. les bals ralentis des administrations générales. La dame vient justement de reprendre ces réceptions officielles, elle croit que c’est fait, que le jeune homme de Savannakhet est entré dans l’oubli. La dame a donc repris ses soirées auxquelles elle est tenue pour que se voir puissent quand même les gens, de temps en temps, et de temps en temps aussi sortir de la solitude effroyable dans laquelle se tiennent les postes de la brousse perdus dans les étendues quadrilatères du riz, de la peur, de la folie, des fièvres, de l’oubli. Le soir à la sortie du lycée, la même limousine noire, le même chapeau d’insolence et d’enfance, les mêmes souliers lamés et elle, elle va, elle va se faire découvrir le corps par le milliardaire chinois, il la lavera sous la douche, longue-ment, comme chaque soir elle faisait chez sa mère avec l’eau fra?che d’une jarre qu’il garde pour elle, et puis il la portera mouillée sur le lit, il mettra le ventilateur et il l’embrassera de plus en plus partout. . . et après elle rentrera à la pen-sion, et personne pour la punir, la battre, la défigurer, l’in-sulter. C’était à la fin de la nuit qu’il s’était tué, sur la grande place du poste étincelante de lumière. Elle dansait. Puis le jour était arrivé. Il avait contourné le corps. Puis, le temps passant, le soleil avait écrasé la forme. Personne n’avait osé approcher. La police le fera. A midi, après l’arrivée des chaloupes du voyage, il n’y aura plus rien, la place sera nette. Ma mère a dit à la directrice de la pension: ?a ne fait rien, tout ?a c’est sans importance, vous avez vu? ces petites robes usées, ce chapeau rose. et ces souliers en or, comme cela lui va bien? La mère est ivre de joie quand elle parle de ses enfants et alors son charme est encore plus grand. Les jeunes surveillantes de la pension écoutent la mère pas-sionnément. Tous, dit la mère, ils tournent autour d’elle, tous les hommes du poste, mariés ou non, ils tournent autour de ?a, ils veulent de cette petite, de cette chose-là, pas tellement définie encore, regardez, encore une enfant. Dés-honorée disent les gens? et moi je dis: comment ferait l’in-nocence pour se déshonorer? La mère parle, parle. Elle parle de la prostitution éclatante et elle rit, du scandale, de cette pitrerie, de ce chapeau déplacé, de cette élégance sublime de l’enfant de la traversée du fleuve, et elle rit de cette chose irrésistible ici dans les colonies fran?aises, je parle, dit-elle, de cette peau de blanche, de cette jeune enfant qui était jusque-là cachée dans les postes de brousse et qui tout à coup arrive au grand jour et se commet dans la ville au su et à la vue de tous, avec la grande racaille milliardaire chinoise, diamant au doigt comme une jeune banquière, et elle pleure. Quand elle a vu le diamant elle a dit d’une petite voix:?a me rappelle un petit solitaire que j’ai eu aux fian?ailles avec mon premier mari. Je dis: monsieur Obscur. On rit. C’était son nom, dit-elle, c’est pourtant vrai. Nous nous sommes regardées longuement et puis elle a eu un sourire très doux, légèrement moqueur, empreint d’une connaissance si profonde de ses enfants et de ce qui:les attendrait plus tard que j’ai failli lui parler de Cholen. Je ne l’ai pas fait. Je ne l’ai jamais fait. Elle a attendu longtemps avant de me parler encore, puis elle l’a fait, avec beaucoup d’amour: tu sais que c’est fini? que tu ne pourras jamais plus te marier ici à la colonie? Je hausse les épaules, je ris. Je dis: je peux me marier par-tout, quand je veux. Ma mère fait signe que non. Non. Elle dit: ici tout se sait, ici tu ne pourras plus. Elle me re-garde et elle dit les choses inoubliables: tu leur plais? Je ré-ponds: c’est ?a, je leur plais quand même. C’est là qu’elle dit: tu leur plais aussi à cause de ce que tu es toi. Elle me demande encore: c’est seulement pour l’argent que tu le vois? J’hésite et puis je dis que c’est seulement pour l’argent. Elle me regarde encore longtemps, elle ne me croit pas. Elle dit: je ne te ^ressemblais pas, j’ai eu plus de mal que toi pour les études et moi j’étais très sérieuse, je l’ai été trop longtemps, trop tard, j’ai perdu le go?t de mon plaisir. C’était un jour de vacances à Sadec. Elle se reposait sur un rocking-chair, les pieds sur une chaise, elle avait fait un courant d’air entre les portes du salon et de la salle à manger. Elle était paisible, pas méchante. Tout à coup-elle avait aper?u sa petite, elle avait eu envie de lui parler. On n’était pas loin de la fin, de l’abandon des terres du barrage. Pas loin du départ pour la France. Je la regardais s’endormir. De temps en temps ma mère décrète: demain on va chez le photographe. Elle se plaint du prix mais elle fait quand même les frais des photos de famille. Les photos, on les regarde, on ne se regarde pas mais on regarde les photographies, chacun séparément, sans un mot de commen-taire, mais on les regarde, on se voit. On voit les autres membres de la famille un par un ou rassemblés. On se re-voit quand on était très petit sur les anciennes photos et on se regarde sur les photos récentes. La séparation a encore grandi entre nous. Une fois regardées, les photos sont rangées, avec le linge dans les armoires. Ma mère nous fait photographier pour pouvoir nous voir, voir si nous grandis-sons normalement. Elle nous regarde longuement comme d’autres mères, d’autres enfants. Elle compare les photos entre elles, elle parle de la croissance de chacun. Personne ne lui répond. Ma mère ne fait photographier que ses enfants. Jamais rien d’autre. Je n’ai pas de photographie de Vinhlong, aucune, du jardin, du fleuve, des avenues droites bordées des tamariniers de la conquête fran?aise, aucune, de la mai-son, de nos chambres d’asile blanchies à la chaux avec les .grands lits en fer noirs et dorés, éclairées comme les classes d’école avec les ampoules rougeoyantes des avenues, les abat-jour en t?le verte, aucune, aucune image de ces endroits incroyables, toujours provisoires, au-delà de toute laideur, à fuir, dans lesquelles ma mère campait, en attendant, disait-elle, de s’installer vraiment, mais en France, dans ces régions dont elle a parlé toute sa vie et qui se situaient selon son humeur, son age, sa tristesse, entre le Pas-de-Calais et l’Entre-deux-Mers. Lorsqu’elle s’arrêtera pour toujours, qu’elle s’ins-tallera dans la Loire, sa chambre sera la redite de celle de Sadec, terrible. Elle aura oublié. Elle ne faisait jamais de photos de lieux, de paysages,. rien que de nous, ses enfants, et la plupart du temps elle nous groupait pour que la photo co?te moins cher. Les quelques photos d’amateur qui ont été prises de nous l’ont été par des amis de ma mère, des collègues nouveaux arri-vants à la colonie qui prenaient des vues du paysage équatorial, cocotiers et coolies, pour envoyer à leur famille. 相关资料 |